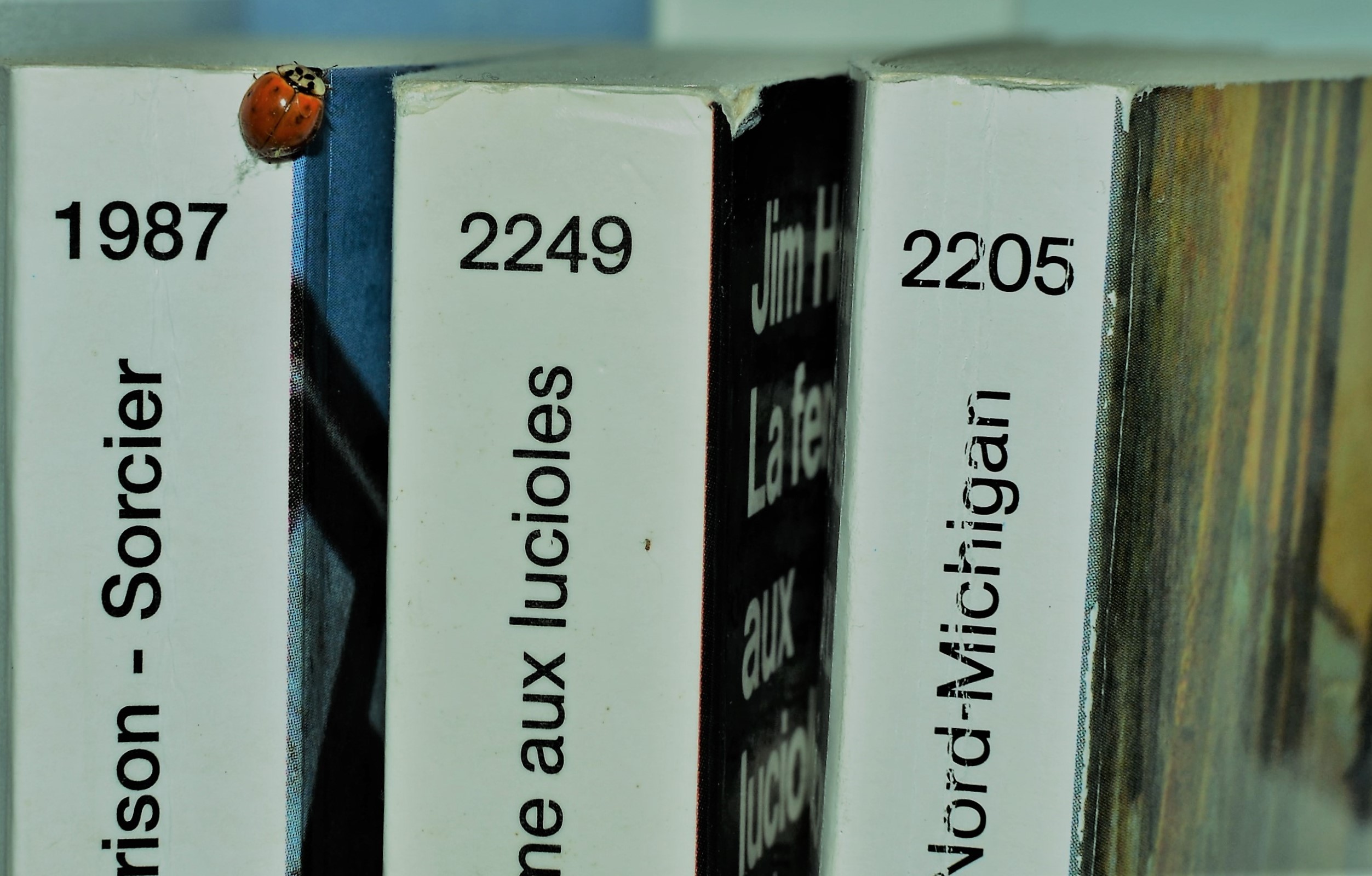Il était une fois sur les terres d’Irlande, dans le comté de Monaghan, l’histoire vraie, si l’on y croit, de Foley McGoohan, dont on ne sait s’il était laid ou si les hommes avaient décidé de le voir ainsi.
Quoiqu’il en fût, aux yeux de tous, la laideur de Foley était telle que nul ne songeait qu’elle pouvait être fortuite. Et comme les êtres pensent avec leurs yeux et non avec leurs âmes, et comme leurs yeux ne percent pas les âmes, ils jetèrent sur lui l’opprobre et le chassèrent des heures comprises entre l’aube et le crépuscule. Ainsi, les nuits de Foley McGoohan devinrent ses jours. Les jours devinrent ses nuits. Et lorsqu’un quidam s’attardait le soir tombé sur la lande, il priait pour ne pas le croiser. Si cela se produisait, il perdait le sommeil, non pas, comme il le croyait, à cause de la disgrâce de Foley, mais de sa bêtise à lui, autrement effrayante.
Durant l’une de ses nuits d’errance, ses pas menèrent Foley devant la demeure de Meallán Callaghan, le conteur. On le disait mourant. On disait que lorsque la mort pétrifierait ses lèvres, ses contes disparaîtraient à jamais, faute d’héritier. Les hommes s’étaient bien pressés à son chevet, car le métier de conteur en séduisait plus d’un, mais Meallán n’en trouva parmi eux aucun qui fut digne de lui succéder.
Foley allait passer son chemin quand la porte s’ouvrit. Une vieille l’invita à entrer. Sedna Callaghan, l’épouse du conteur. Il hésita, mais l’insistance joyeuse de la femme le convainc. Elle attrapa sa main et le mena silencieusement vers la chambre de Meallán. Elle poussa une chaise près du lit et sortit de la pièce.
Foley McGoohan s’assit près du conteur qui se tourna vers lui et l’observa longuement. Par longuement entendez de longues heures. Le jeune homme baissa la tête pour ne pas exposer son visage disgracieux. Mais Meallán mit le poing sous son menton et l’obligea à la relever. Peu à peu, Foley oublia sa laideur, car elle ne transparaissait pas dans les yeux du vieillard. Il releva la nuque et se prêta à l’observation insistante avec un certain plaisir. À la vérité, Meallán Callaghan scrutait son âme. Et parce qu’il vit en elle la vivacité, la noblesse et la clarté des conteurs, il fit de Foley son héritier.
Durant les dix-sept jours suivants, il lui conta les mille histoires que renfermait sa mémoire. Et quand son trésor eut changé de cassette, il s’éteignit à l’aube d’un jour dont il n’avait plus que faire. Sedna scella alors les lèvres de son époux et raccompagna Foley à la porte. Voyant que celui-ci hésitait à la franchir, elle l’assura que plus rien ne subsistait du passé. Celui-ci était mort, aussi mort que Meallán Callaghan. Il était à présent le conteur du Comté de Monaghan et nul ne songerait à attenter aux jours d’un homme d’une telle importance. Elle se fourvoyait, bien sûr, comme on se fourvoie toujours sur les intentions humaines.
Foley McGoohan emprunta le chemin qui descendait au village. Fort des paroles de Sedna, il marchait d’un pas assuré, le visage découvert. Il portait le manteau du conteur mais cela ne le sauva pas. Les premiers hommes qui croisèrent sa route le rouèrent de coup et l’abandonnèrent gisant sur la lande, afin qu’il apprenne que le jour n’était pas son domaine. Il ne mourut pas. Mais son héritage s’échappa par le filet de sang qui coulait de sa tempe et se déposa sur le sol irlandais. Le vent lui ravit les mille contes hérités de Meallán Callaghan. Dès lors, Foley McGoohan erra toutes les nuits dans la lande balayée par les souffles puissants pour reprendre son bien. Mais le vent, se plaisant en conteur, refusa de le lui rendre. On dit que Foley erre encore et que tant qu’il en sera ainsi, les habitants du Comté de Monaghan ne passeront pas de nuits sereines, car l’ennui hantent leurs demeures et assèche leurs âmes.
Ce que je sais, c’est qu’il y a peu de chance qu’un être, aussi laid soit-il, effraie le vent. Peu de chance qu’une âme brisée de main d’homme trouve la guérison. Peu de chance que le jour devienne le domaine de Foley McGoohan.