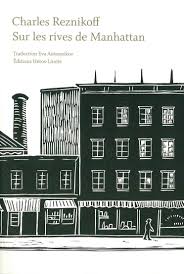Mary Wlaseck n’aime ni les hommes, ni les femmes, ni les enfants, ni les animaux. Elle n’aime rien qui a un cœur. Rien qui peut tomber là sous vos yeux et ne plus jamais se relever, à cause de l’arrêt brutal de ce cœur. Elle n’aime pas non plus ce qui est mort, mais c’est mort, alors plus rien ne peut arriver. Pas de mauvaise surprise. Elle aime les livres. Les personnages de livres. Pas de sang, pas de chair, pas de cœur. Et s’ils meurent, c’est pour de faux. Enfin, non. Mais elle peut l’ignorer, revenir en arrière. Lire les mêmes passages encore et encore.
Mary Wlaseck n’aime personne et personne ne l’aime. À cause de son mauvais caractère et de son manque de considération envers le genre humain. Les seuls points qu’elle marque, elle les doit à sa beauté et ça l’emmerde. Sauf quand elle cherche de la compagnie. Plus souvent des femmes que des hommes, parce qu’elle ont un cœur plus solide et moins bruyant et qu’elles ne le font pas monter dans les tours en deux minutes chrono.
Quand elle est appelée sur la scène de crime de la huitième avenue et découvre la fille avec sa poitrine béante et son cœur dans la main, Mary Wlaseck ressent l’étrange sensation de connaître l’assassin. Et dans les jours qui suivent, elle doit lutter contre la pensée tenace et déroutante qu’elle n’est plus seule au monde. Durant son interrogatoire, la mère de la victime, à qui on a dissimulé les détails macabres de l’affaire, dit d’une voix atone : Qui pouvait lui en vouloir ? Ma fille avait le cœur sur la main. Les flics en rient encore longtemps après, sauf le lieutenant Wlaseck. D’une manière ou d’une autre, le cosmos met toujours la vérité dans la bouche des vivants. Ils en font ce qu’ils en font.
New York, 1989.